De retour de Gaza, des médecins témoignent du désastre et interrogent la torpeur européenne : "Nous reste-t-il encore un peu d'humanité
?"
Cinq médecins et deux infirmières, français et suisse,
qui ont effectué plusieurs missions humanitaires dans l’enclave palestinienne depuis novembre 2023, racontent au « Monde » l’impossibilité de répondre aux besoins de la
population. Et comment cette expérience les a marqués.
En plongeant dans ses souvenirs, Mehdi El Melali, un urgentiste français de 33 ans, s’interrompt, submergé par l’émotion. Aucun mot ne décrit fidèlement
l’enfer de la bande de Gaza. Lui n’y a passé que trois semaines, du 4 au 25 juillet 2024, lors d’une mission organisée par les organisations Al-Rahma et PalMed Europe. La
violence de son récit tranche avec la douceur de cette soirée d’été, dans un café parisien. « Une partie de moi est un peu restée là-bas, s’excuse-t-il.
J’ai du mal à couper. » Comme d’autres humanitaires européens, il en a conçu une profonde solitude.
« On en revient transformé », confirme le chirurgien orthopédiste François Jourdel. A 54 ans, ce vétéran de la
médecine a effectué son premier terrain en 1997, en Angola. Gaza, insiste-t-il, est unique : « Les bombardements y sont incessants et les gens ne
peuvent pas fuir. Toute la population est touchée. » Il n’est pas le seul professionnel à dresser ce constat effaré. A bien des égards, la situation créée par l’assaut
de l’Etat hébreu sur Gaza – il dure depuis vingt-deux mois –, après l’attaque du Hamas palestinien contre Israël, le 7 octobre 2023, est sans commune
mesure avec ce qu’ils ont vu ailleurs.
Cinq médecins et deux infirmières – six Français et une Suissesse – ont accepté de partager avec Le Monde leur expérience dans
les hôpitaux de Gaza. Tous ont été choqués par la proportion extrêmement élevée d’enfants parmi les victimes. Les blessés qu’ils ont soignés sont
représentatifs de la société gazaouie – preuve, selon eux, du caractère indiscriminé des bombardements israéliens.
Dès l’arrivée dans l’enclave, leur regard a buté sur des ruines, des squelettes d’immeubles et des souvenirs anéantis. Les gestes de la vie quotidienne sont dominés
par le bourdonnement oppressant des drones et par les explosions qui déchirent le ciel. Au début de la guerre, en novembre 2023, François Jourdel en compte « parfois jusqu’à cinq ou six, en une minute ». Ces bombardements sont « d’une
extrême violence, comme un tremblement de terre. Tout l’hôpital était secoué par des ondes de choc qui faisaient trembler les vitres », relate le chirurgien parti avec l’ONG Médecins
sans frontières (MSF).
« Des patients par terre, éviscérés »
Les hôpitaux saturent. « C’est un volume de blessés qui submergerait n’importe quel grand hôpital parisien », affirme
le médecin, qui vit et travaille à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Le suivi postopératoire est quasi-impossible. Sans fichier informatique ni chambre attribuée, alors que les couloirs grouillent
de malades et de déplacés venus chercher un abri, une partie des patients repart sans avoir reçu de soins.
Depuis son bureau à Chamonix, en Haute-Savoie, Karin Huster parle sans détour. L’infirmière de 58 ans a effectué une vingtaine de missions humanitaires à
travers le monde depuis 2014. Elle s’est rendue trois fois à Gaza, en 2024, en tant que responsable des activités médicales de MSF. Entre juin et juillet de cette année-là, lors de son
deuxième séjour, elle était basée à l’hôpital Al-Aqsa, à Deir Al-Balah, dans le centre de l’enclave. Avec trois lits aux urgences, le seul établissement encore préservé à l’époque tenait
plus de la clinique que de l’hôpital. « Des patients gisaient par terre, éviscérés, décrit-elle. Quand ils mourraient, on
les poussait dans un coin : on n’avait pas le temps de les emmener à la morgue parce que d’autres blessés arrivaient. »
Chaque missile charrie des vagues de blessés. « Stop, je n’en peux plus ! », se souvient avoir pensé Mehdi El
Melali, l’urgentiste. Dans le nord de Gaza, à
l’hôpital indonésien, il se rappelle avoir reçu une trentaine de blessés, tous de la même famille, qui dormaient au moment de l’explosion. Un garçon de
8 ou 9 ans est déclaré mort à son arrivée. « La mère était un peu perturbée, elle ne savait pas trop quoi faire, raconte-t-il. On lui a dit que l’un de ses fils était décédé. Elle l’a embrassé sur le front, puis elle s’est mise à compter ses autres enfants en cherchant son quatrième, âgé de
14 ans. Il n’était pas là. On ne l’a jamais retrouvé. »
Les souvenirs de l’urgentiste mêlent le médical et son propre ressenti. L’immense majorité des blessés sont victimes des bombardements. Quelques-uns, dans le nord
de l’enclave, sont touchés par des tirs de drones quadrirotor. Quand un missile frappe une habitation, beaucoup ne survivent pas. Ceux qui s’en sortent ont les chairs déchiquetées, les membres
arrachés ou écrasés par les murs effondrés de leurs maisons. Le souffle de l’explosion provoque parfois des lésions dans les organes, difficiles à détecter sans échographie. Mehdi El Melali a
remarqué que, dans le Nord, les blessés – notamment des enfants – étaient criblés de petits éclats de métal noirs.
La mort banalisée
Dans son bureau, à Grandvaux, en Suisse, Sonam Dreyer-Cornut rabat nerveusement une mèche de cheveux. Cette infirmière de 36 ans, responsable médicale pour
MSF, est sortie de Gaza à la fin du mois d’avril. Elle a connu la trêve, entrée en vigueur le 19 janvier. Et assisté à la reprise des bombardements, le 18 mars, qui a ruiné la fragile reconstruction du système de santé. Beaucoup de rescapés, constate-t-elle alors, souffrent de
graves brûlures. Pour cicatriser correctement, ils doivent absorber au moins 3 000 calories par jour. Or, à la fin de sa mission, après deux mois de siège total, il n’y avait plus de farine
à Gaza. A peine restait-il quelques boîtes de conserve – les fruits et la viande avaient disparu depuis plusieurs semaines. « Leurs plaies ne cicatrisaient pas, ça prenait deux fois plus de temps, se rappelle l’infirmière. Certains surinfectaient par
manque d’accès à l’eau pour nettoyer les plaies. » C’était avant que la famine ne se généralise dans l’enclave palestinienne.
A Gaza, les vies sont à l’image des corps, en lambeaux. Un oncle s’occupe de ses neveux orphelins ; une voisine fait parfois office de grand-mère. Un jour,
Sonam Dreyer-Cornut voit arriver une petite fille blessée accompagnée d’un garçon de 12 ans au visage brûlé. Il était devenu chef de famille : le plus âgé encore en vie pour
s’occuper d’une ribambelle de frères et de cousins, eux aussi orphelins. Certains enfants arrivent en état de stress aigu, « complètement mutiques, le
regard fixe, l’air hagard, se remémore l’infirmière. Ils ne bougent plus, ne parlent plus, ne pleurent pas », malgré des blessures parfois très
lourdes.
La mort a été banalisée. L’anesthésiste et réanimatrice Aurélie Godard se souvient d’un « monsieur d’une cinquantaine
d’années » dont la jambe avait été blessée lors d’une explosion, à Deir Al-Balah. « Il me dit : “Est-ce que je peux m’absenter deux
heures ? Il faut que j’aille enterrer mes fils.” Il a dit ça comme ça. Ça faisait froid dans le dos. »
La médecin de 44 ans, qui exerce à Annecy, parle d’une voix douce. Elle esquisse un sourire quand elle évoque ses collègues palestiniens. Elle a effectué
trois missions à Gaza pour MSF en 2024, constatant à chaque fois plus de destructions. Dans le Sud, Rafah n’existe plus, Khan Younès est dévastée. Le Nord est un champ de ruines. Les
restrictions israéliennes laissent aux Gazaouis tout juste de quoi respirer, sans dignité ni espoir.
L’infirmière Karin Huster a travaillé à Mossoul en Irak, en Haïti, dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo, dans des pays avec des « systèmes corrompus ou qui cassent les gens, dans des situations de guerre ». « Mais moi, jamais je n’avais connu
une telle situation dans laquelle la population n’a pas le droit d’exister, dit-elle. A Gaza, c’est la population civile qui paie. Israël a les moyens
d’éviter ça, mais il choisit d’être inhumain. »
L’impression de servir à quelque chose
Plus de 60 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7-Octobre, selon le ministère de la santé dirigé par le Hamas – des données jugées fiables par
les Nations unies. Ce bilan n’inclut que ceux qui ont été identifiés. Des milliers de corps sont sous les décombres. D’autres sont morts des conséquences de la guerre, de cancers, d’AVC ou de
maladies chroniques non soignées… Et dans la douleur : les médecins préfèrent garder les anesthésiants pour les opérations. On manque de pansements, de médicaments,
d’antibiotiques.
En avril 2024, Samyr Addou effectuait sa première mission en zone de conflit – quinze jours à l’hôpital Nasser, à Khan Younès. Le chirurgien
orthopédiste de 58 ans s’était préparé aux blessures de guerre, mais il a été choqué d’opérer en grande majorité des enfants et des femmes. Les patients étaient ensuite allongés à
même le sol, avec « des plaies puantes, béantes, infestées de vers ». Depuis, il doute : « Est-ce que
je n’ai pas prolongé des souffrances ? » La voix s’éraille, il s’agace un peu. Il a l’impression d’avoir déjà tout raconté aux médias : les enfants amputés, l’horreur de
la guerre… Sans que cela suscite de réaction : « Parlons de nous, en France, de notre humanité : est-ce qu’il nous en reste encore un
peu ? »
A Gaza, les soignants ont l’impression de servir à quelque chose. Tous cherchent donc à y retourner. Samyr Addou a été refoulé par les autorités israéliennes,
en mars, alors qu’il disposait des permis requis. Pascal André, un urgentiste qui a effectué une mission de quinze jours dans l’hôpital européen de Khan Younès en février 2024, a tenté à
quatre reprises d’y revenir – ses autorisations ont été annulées par Israël au dernier moment. Sur place, « c’est grâce aux collègues palestiniens
qu’on tient dans l’enfer », résume Mehdi El Melali, qui sourit au souvenir des rares pauses, quand les médecins gazaouis lui confiaient leurs peines de cœur et leurs souvenirs
d’avant la dévastation. Leur endurance impressionne les humanitaires. Tous insistent : les Gazaouis ne sont pas consumés par la haine, même à l’égard d’Israël. Ils veulent juste en
finir avec le carnage ; ils réclament justice.









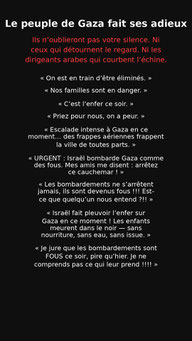




Écrire commentaire